



ARSLA - Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique et autres Maladies du Motoneurone

';
mea = true;
}
else if (is_gauche) {
new_content3 = '
Tweeter
Retour
' + new_content2.html() + '
';
is_gauche = false;
}
else {
new_content3 = '' + new_content2.html() + '
';
is_gauche = true;
}
if (new_content2.html() != null) new_content += new_content3;
}
if (mea) {
var nbr = page_index*items_per_page+max_elem;
new_content2 = jQuery('.global_act .1_act:eq('+nbr+')').clone();
if (is_gauche) { new_content3 = '' + new_content2.html() + '
'; is_gauche = false; }
else { new_content3 = '' + new_content2.html() + '
'; is_gauche = true; }
if (new_content2.html() != null) new_content += new_content3;
}
$('#Searchresult').empty().append(new_content);
return false;
}
/* Initialisation function for pagination */
function initPagination() {
// count entries inside the hidden content
var num_entries = jQuery('.global_act .1_act').length;
var actu_mea = jQuery('.global_act .actumea').length;
// Create content inside pagination element
$("#Pagination2").pagination(num_entries-actu_mea, {
callback: pageselectCallback,
items_per_page:4,
prev_text: ""
});
$("#Pagination2").trigger('setPage', [0]);
if ( num_entries > 0 )
{
$("#Pagination2").css({ display: 'block' });
}
}
// When document is ready, initialize pagination
$(document).ready(function(){
initPagination();
if ($('.pagination').html() == '<1<>') {
$('.pagination').css('display', 'none');
}
});
 Synthèse du compte-rendu du groupe bibliographique de la coordination des centres SLA
Synthèse du compte-rendu du groupe bibliographique de la coordination des centres SLA
La recherche sur la SLA
Dr Laurence CARLUER, Centre SLA de Caen (Hôpital Côte de Nacre)
Groupe bibliographique :
Pierre-François PRADAT (Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Centre SLA de Paris), Sharam ATTARIAN (Hôpital de la Timone, Marseille), Jean-Philippe CAMDESSANCHE (Hôpital Nord, Saint-Etienne), Pascal CINTAS (CHU de Rangueil, Toulouse), Philippe CORCIA (Hôpital Bretonneau,Tours), Andoni ECHANIZ-LAGUNA (Hôpital Civil, Strasbourg), Jesus GONZALEZ (Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris), Nathalie GUY (Hôpital Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand), Guillaume NICOLAS (Hôpital Hôtel Dieu, Angers), Thierry PEREZ (Hôpital Roger Salengro, Lille), Marie-Hélène SORIANI (Hôpital L’Archet, Nice), Nadia VANDENBERGHE (Hôpital Pierre Wertheimer, Lyon), Annie VERSCHUEREN (Hôpital de la Timone, Marseille) au nom de la Coordination nationale des Centres de prise en charge des patients atteints de SLA.
1) Introduction et méthodologie
La coordination nationale des centres de référence et de compétence pour la prise en charge des patients atteints de Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) a mis en place un groupe bibliographique qui réunit des experts, neurologues et pneumologues, provenant des différents centres français. Sa mission est de diffuser auprès de la communauté neurologique et scientifique un compte rendu des avancées dans le domaine de la recherche aussi bien fondamentale que clinique. Pour la présente revue, la recherche documentaire a utilisé la base de données bibliographique Medline sur internet.
Le texte ci-dessous est la synthèse résumée du compte rendu fait par le groupe bibliographique, lequel est paru dans la Revue Neurologique.
2) Génétique
2-1) Gène SOD1 : un mauvais modèle animal de SLA sporadique ?
Des mutations du gène codant pour l’enzyme de la superoxyde dismutase 1 (SOD1) sont responsables dans l’espèce humaine de la forme familiale la plus fréquente de SLA (environ 20% des cas familiaux). Ces mutations provoquent la formation d’agrégats (accumulation de protéines) intracellulaires anormaux de protéine SOD1 et la mort progressive des motoneurones. Les souris transgéniques SOD1-SLA sont étudiées depuis plus de 15 ans, mais force est de constater que la plupart des traitements efficaces sur ces modèles murins ne sont pas efficaces sur la SLA sporadique (non familiale) humaine qui représente plus de 80% des cas. La question de savoir si ces souris SOD1-SLA sont un bon modèle de SLA sporadique notamment pour tester des nouveaux médicaments est donc récurrente dans la littérature depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, une équipe canadienne a recherché des agrégats anormaux de SOD1 dans la moelle épinière de patients ayant une SLA sporadique ainsi que de patients ayant une SOD1-SLA. Sans surprise, des agrégats anormaux ont été détectés chez les patients SOD1-SLA, mais pas chez les patients avec une SLA sporadique. Ce résultat suggère donc bien que la SLA SOD1 est différente de la SLA sporadique et permet peut-être de mieux comprendre pourquoi les traitements efficaces chez les souris SOD1-SLA ne sont pas efficaces dans la SLA sporadique humaine. Ce travail est une pierre de plus à l’édifice de ceux qui pensent que les modèles murins SOD1-SLA sont de mauvais modèles de SLA sporadique.
2-2) Gène TARDBP : Création d’un modèle animal TDP-43
L’étude de la protéine TDP-43 est depuis ces deux dernières années l’une des principales thématiques de recherche et d’étude dans la SLA et aussi dans la démence fronto-temporale (DFT). En effet, ces deux affections totalement différentes sur le plan clinique se caractérisent par l’existence d’une accumulation dans les cellules d’une même protéine appelée TDP-43. La protéine TDP-43 est codée par le gène TARDBP. L’implication de TDP-43 dans la physiopathologie de la SLA est suggérée par la présence de cette protéine dans les neurones des patients SLA et sur l’existence de cas de SLA associés à des mutations du gène TARDBP.
Afin de mieux comprendre le rôle de cette protéine dans la dégénérescence des neurones moteurs, l’équipe de R Baloh (St Louis, USA) a mis au point un modèle de souris exprimant un gène TARDBP humain muté. Les principaux résultats de cette étude sont les suivants. D’abord, une maladie des neurones moteurs survient chez cette souris. En effet, cette souris TDP-43 qui a une évolution normale jusqu’à l’âge de 3-4 mois développe ensuite des troubles de la marche. A 4,5 mois elle présente une perte de poids importante. L’atteinte motrice va évoluer jusqu’à empêcher à la souris tout déplacement autrement qu’en rampant. Enfin, on retrouve dans les tissus des souris des fragments de la protéine TDP-43. On ne sait pas encore le rôle de la protéine TDP43 mutée à savoir si elle est inactive (activité pathogène indirecte) ou si elle a une fonction nouvelle mais délétère (activité pathogène directe).
2-3) Gène FUS/TLS et SLA
L’autre gène majeur étudié en 2009 était le gène FUS/TLS (FUsed in Sarcoma /Translated in LipoSarcoma). Ce gène code une protéine dont les fonctions sont similaires à celles de TDP-43. En effet, la protéine FUS se trouve dans le noyau des motoneurones où elle contribue entre autres à la restauration de l’ADN. Plusieurs équipes se sont intéressées en 2009 à la fréquence de la mutation FUS/TLS dans la SLA familiale et sporadique. Les points d’accord entre ces différents travaux concernent la fréquence des mutations FUS qui sont plus souvent retrouvées dans les formes familiales et représentent moins de 1% des formes sporadiques. Les patients atteints de SLA avec mutation FUS/TLS auraient en commun un début précoce, une atteinte symétrique et proximale des ceintures dès les stades précoces de la maladie et un début fréquent par un syndrome de la tête tombante.
3) Epidémiologie et environnement
3-1) Incidence de la SLA
De récentes études prospectives européennes et américaines ont rapporté des taux d’incidence similaires, compris entre 1,5 et 2,5 cas/100.000 habitants/an (nombre de nouveaux cas de SLA pour 100 000 habitants et par an). A contrario, trois études suggèrent une augmentation du taux d’incidence sur les 10 à 20 dernières années allant de 1,92/100 000 (étude italienne) à 2, 98 / 100 000 (étude suédoise) et à 3,3/ 100 000 (étude néo-zélandaise). Cette augmentation soulève à nouveau la question de facteurs environnementaux et/ou génétiques comme facteurs de susceptibilité à développer la maladie.
3-2) Facteurs de risque
La recherche de facteurs de risque non génétiques a fait l’objet de nombreuses études dans les dernières décennies mais le lien entre la SLA et des facteurs de risque comme l’activité physique, l’exposition aux pesticides ou au plomb, ou encore les traumatismes n’apparaît pas significatif ou reste à ce jour seulement possible.
3-3) Tabagisme
La recherche systématique d’une association entre tabagisme et SLA est plus nouvelle. Une étude récente a bénéficié des données de la cohorte très large de l’European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition portant sur 517.890 sujets avec un suivi médian de 10 ans. Cent dix-huit cas de décès par SLA ont été identifiés, et parmi eux les fumeurs étaient deux fois plus fréquents que les non-fumeurs. Ce risque tendait à augmenter avec la quantité de tabac consommé, et diminuait avec le nombre d’années de sevrage. Ces résultats apportent des arguments supplémentaires en faveur d’un risque de SLA plus élevé chez les fumeurs. Un des mécanismes avancés est lié au formaldéhyde qui est un des composants majeurs de la fumée de cigarette et dont l’effet neurotoxique est présumé. Le formaldéhyde est un gaz incolore fortement irritant, utilisé dans de nombreux secteurs industriels, et considéré en France comme cancérigène depuis 2004. Or, une étude prospective sur une cohorte de sujets participant à la Cancer Prevention Study-II vient de mettre en évidence une augmentation du risque relatif de SLA chez les personnes exposées au formaldéhyde.
3-4) Footballeurs professionnels : un risque non lié à l’activité physique ?
Une publication antérieure avait montré une augmentation significative du risque de développer une SLA chez les footballeurs professionnels italiens. Les auteurs ont poursuivi leur étude en suivant cette population (n=7325) et en la comparant à deux autres groupes d’athlètes professionnels (1973 basketteurs et 1701 cyclistes). Les résultats confirment le risque plus élevé de SLA chez les footballeurs, avec un risque supérieur pour les carrières de plus de 5 ans, et un âge moyen de début jeune (41,6 ans). L’absence de cas de SLA parmi les basketteurs et les cyclistes suggère que la SLA n’est pas directement liée à l’intensité de l’activité physique.
3-5) Champs électriques et magnétiques
Une revue des études menées depuis 20 ans sur les expositions professionnelles à des champs électriques et magnétiques vient d’être effectuée par un groupe de travail américain. Cette revue très complète fait clairement ressortir les résultats contradictoires des différentes études et ne permet pas de conclure quant à l’effet des champs électriques et magnétques.
4) Electrophysiologie
La stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) (technique consistant à appliquer une impulsion magnétique sur l'encéphale à travers le crâne de façon indolore) pourrait avoir un effet modulateur sur les circuits glutamatergiques (le glutamate est un neurotransmetteur dont le rôle délétère est démontré dans la SLA). Compte tenu du rôle potentiellement délétère du glutamate dans la SLA, une équipe italienne a réalisé une étude en évaluant l’efficacité d’une rTMS appliquée cinq jours par mois pendant un an sur le déclin de l’échelle ALSFRS-R. L’étude, menée sur trente patients, n’a pas montré d’efficacité de la rTMS.
5) Marqueurs biologiques
La SLA est associée à des inclusions (accumulation de protéines) dans les motoneurones positives pour la protéine TDP-43 et certaines formes familiales rares sont associées à des mutations de ce gène. Deux équipes ont récemment trouvé une augmentation des taux de protéine TDP-43 dans le liquide cérébro-spinal (LCS) par rapport à des sujets sains. Toutefois, le chevauchement des valeurs entre les deux populations ne permet pas d’envisager une utilisation de ce marqueur à visée diagnostique.
Une étude réalisée à la Pitié-Salpêtrière s’est penchée sur le métabolisme glucidique chez des patients souffrant de SLA. Alors que la glycémie (taux de sucre dans le sang) à jeun des patients était comparable à celle des sujets sains, elle était en moyenne plus élevée après une charge orale en glucose chez les patients SLA. La présence de troubles du métabolisme glucidique n’était pas associée à la sévérité de la maladie et notamment à la force musculaire ou au degré d’atrophie.
Cette étude apporte des arguments supplémentaires en faveur de l’existence d’anomalies métaboliques dans la SLA. Elle n’apparaît pas comme une conséquence de l’atrophie musculaire susceptible de diminuer le transfert du glucose du sang vers le muscle. Une hypothèse est qu’elle soit liée à une lipolyse (dissolution des graisses).
6) Evaluation respiratoire
L’évaluation clinique de la dyspnée (essoufflement) est probablement plus pertinente que la mesure de la Capacité Vitale (la Capacité Vitale correspond au volume d’air que les poumons peuvent mobilisés) pour la surveillance respiratoire des patients. Une étude provenant du centre SLA de Lille s’est intéressée à la pertinence d’une échelle clinique (score de dyspnée de Borg), en position assise et en position allongée, chez 72 patients SLA. Cette étude montre que l’évaluation de la dyspnée par une échelle clinique simple d’utilisation, permet d’apprécier, dès la première consultation ou dans le suivi clinique, l’état de la fonction musculaire respiratoire et de préciser le délai pour la réalisation des épreuves fonctionnelles respiratoires.
7) Troubles nutritionnels
7-1) Nutrition et physiopathologie
Deux études rapportent une augmentation des besoins énergétiques de repos (hypermétabolisme) chez les patients atteints d’une SLA. Un travail publié par une équipe de Limoges constatait un hypermétabolisme chez 100% (11/11) des patients présentant une forme familiale (cas non liés à une mutation de SOD1) et 52% des patients présentant une forme sporadique (17/33), et cela parfois même depuis le début de la maladie. Une autre étude montrait que l’hypermétabolisme, objectivé dans les mêmes proportions, semblait indépendant de l’évolution de l’affection. L’hypermétabolisme chez les patients atteints d’une SLA dans un contexte familial est peut être lié à la perturbation d’une voie métabolique commune, aboutissant à un déséquilibre énergétique. Il reste à démontrer s’il s’agit d’un mécanisme responsable de la maladie ou d’un mécanisme compensatoire visant à limiter notamment la production de radicaux libres dans la cellule.
7-2) Nutrition orale
Une revue générale sur la prise en charge nutritionnelle rappelle que la complémentation nutritionnelle (vitamines, oligoéléments, L-carnitine, acide alpha lipoique, coenzyme Q10, mélatonine, chélateurs du cuivre) n’a pas démontrée d’efficacité en tant que traitement. Elle reste importante à prendre en considération car dénutrition et exercice physique intense, sont délétères sur l’évolution de la maladie. On ne peut établir de règles quant aux contenus des apports oraux, mais l’objectif de la complémentation est d’éviter une dénutrition protéino-calorique. En effet, la dénutrition qui est un facteur de mauvais pronostic, est d’autant plus importante à considérer qu’il existe un hypermétabolisme comme évoqué plus haut dans la SLA. La recherche précoce d’un hypermétabolisme, par la mesure de la dépense énergétique de repos, devient ainsi un élément pertinent de la prise en charge, dans un objectif de prévention.
8) Essais thérapeutiques de neuroprotection
8.1) Essais pharmacologiques
8-1-1) Lithium
L’un des évènements les plus marquants de l’année 2008 dans le domaine de la SLA avait été la publication par une équipe italienne dans la revue PNAS d’un article en faveur d’un effet spectaculaire du lithium chez les souris SOD1-SLA mais aussi chez des patients souffrant de SLA. Cet article a suscité beaucoup d’interrogations et de controverses. Les résultats rapportés chez les patients SLA n’apportaient pas d’arguments suffisants pour conclure à l’efficacité réelle du lithium chez l’homme. Depuis cette publication, plusieurs essais contrôlés ont été entrepris en Europe et aux Etats-Unis mais leurs résultats n’ont pas encore été publiés au moment de la rédaction de cette revue. Il est toutefois important de signaler que deux études pré-cliniques indépendantes n’ont pas confirmé l’efficacité du lithium dans le modèle animal (souris SOD1-SLA).
8-1-2) Autres molécules
Un essai a évalué l’effet de l’administration systémique d’un facteur de croissance (un facteur de croissance est une substance organique nécessaire à la croissance d'un micro-organisme et qui ne peut être synthétisée par celui-ci), l’IGF-1, chez des patients souffrant de SLA. Le traitement a été bien toléré. Aucun effet positif n’a été observé ni sur la motricité ni sur la survie.
Un facteur de croissance granulocytaire recombinant (G-CSF)a été étudié chez 39 patients SLA. Après un suivi d’un an, aucun effet significatif n’a été observé.
Une autre étude a évalué l’effet du valproate de sodium dans la SLA. Un essai a été réalisé dans deux centres en Hollande. Cet essai, qui a inclus 163 patients souffrant de SLA, n’a pas montré d’effet significatif sur la survie qui était le critère d’efficacité primaire.
Par ailleurs, un essai avec l’acétate de glatiramère (40 mg/jour) avait été conduit chez 366 patients. La tolérance était bonne, mais aucun effet positif n’a été observé.
Une étude a concerné le coenzyme Q10 dont l’effet anti-oxydant est important. Un allongement de la survie avait été rapporté dans un modèle murin de SLA. Aucun effet significatif du traitement n’a été observé dans cet essai réalisé aux Etats-Unis.
8.2) Essais en thérapie cellulaire
Trois publications récentes concernaient des approches de thérapie cellulaires (la thérapie cellulaire vise à soigner des cellules ou à soigner un organisme par l'apport de cellules modifiées ou au statut particulier). Une équipe italienne, qui avait déjà publié des travaux utilisant cette approche, rapporte des résultats obtenus chez 10 patients SLA. Des cellules souches mésenchymateuses isolées à partir de la moelle osseuse ont été injectées dans la moelle épinière à un niveau thoracique haut. Les auteurs n’ont pas observé d’effets secondaires cliniques graves ni d’anomalies à l’imagerie, et notamment pas de développement tumoral. Deux autres travaux basés sur l’injection de cellules souches d’origine sanguine (cellules pouvant se renouveler indéfiniment et pouvant donner des cellules « plus spécialisées ») ont été publiés par des équipes qui n’ont pas d’expertise connue dans le domaine de la SLA. Dans une des deux études, les cellules étaient injectées directement dans la partie antérieure de la moelle épinière cervicale chez 13 patients. Les auteurs font état après un suivi d’un an d’une amélioration clinique chez 9 patients et d’une stabilisation dans un cas. La tolérance du traitement était jugée bonne. Dans une autre étude, les cellules étaient injectées dans la partie antérieure du cerveau. La tolérance était jugée bonne. Sur la base d’une comparaison avec dix patients non traités, les auteurs faisaient état d’un allongement significatif de la survie. Il est important de souligner qu’en l’absence d’étude contrôlée (comparaison avec un placebo), ces deux études ne permettent absolument pas de conclure positivement sur l’effet thérapeutique de ce type de thérapie cellulaire.
9) Traitements symptomatiques
Les problèmes de bavage sont particulièrement fréquents et de traitement difficile. La place des injections de toxine botulique dans les glandes salivaires reste discutée en raison d’études avec un faible nombre de patients, de l’utilisation de techniques et de doses variables et de difficultés d’évaluation des bénéfices. Une nouvelle étude a évalué l’intérêt de l’injection de toxine botulique dans les parotides et les glandes sous-maxillaires par guidage électromyographique. Cette étude a impliqué 20 patients. A 4 semaines, 60% des patients traités faisaient état d’une impression d’amélioration importante contre 11% dans le groupe placebo. Cependant, malgré la persistance d’une tendance en faveur du traitement, cet effet n’était plus significatif à 8 semaines. Par ailleurs, cette étude met de nouveau en évidence les difficultés d’évaluation du bénéfice thérapeutique. Ainsi, par exemple, à 12 semaines, à la fin de l’étude, les patients percevaient une amélioration significative de leur problème salivaire et de l’épaisseur de cette salive alors que les cliniciens et les aidants ne notaient aucune modification.
10) Conclusion
Cette revue de la littérature récente montre que la recherche dans la SLA est extrêmement active. Les avancées en génétique sont extrêmement importantes. Si le bilan des essais thérapeutiques récents reste décevant, des progrès devraient permettre la mise au point de nouveaux modèles animaux, l’identification de nouveaux marqueurs de la maladie et l’émergence de nouvelles pistes de traitements neuroprotecteurs. Les travaux de recherche clinique soulignent également les progrès réalisés dans la prise en charge des patients, notamment en ce qui concerne les aspects nutritionnels et respiratoires.
Tweeter
Retour




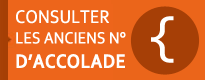

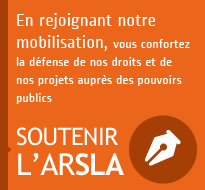

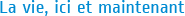
 ARSLA 75 avenue de la République, 75011 Paris - www.arsla-asso.com - Fax : 01 43 38 31 59 -
ARSLA 75 avenue de la République, 75011 Paris - www.arsla-asso.com - Fax : 01 43 38 31 59 -