



ARSLA - Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique et autres Maladies du Motoneurone

';
mea = true;
}
else if (is_gauche) {
new_content3 = '
Accompagner un malade atteint de SLA
2007 - Hélène DANOWSKI
Je voudrais tout d'abord remercier Emmanuel Hirsch de m'avoir accordé sa confiance en me demandant d'apporter ce témoignage sur l'accompagnement de mon mari atteint de SLA depuis l'été 1995, où les premières fasciculations musculaires sont apparues, jusqu'en janvier 2003 où il est mort, la maladie ayant atteint ses muscles respiratoires, et la trachéotomie pratiquée ne lui ayant pas permis de prolonger sa vie.
J'insisterai sur le fait que c'est un témoignage.
Chaque accompagnement est personnel et dépend de la personnalité de chacun des intervenants.
En premier, là ou les personnes qui vivent avec le malade, puis la famille, les amis et les soignants.
Mon témoignage sera sûrement différent de celui qu'auraient pu faire les accompagnants de mon voisin.
Chacun a sa manière d'être, de penser et d'agir.
Je vais essayer de vous dire ce qui m'a paru important pendant ses sept années d'accompagnement.
Quelques mots me viennent en premier pour l'accompagnant : entendre les angoisses, rassurer, soutenir, encourager, anticiper, et surtout aider le malade à vivre la vie quotidienne.
Présentation de la situation :
Mon mari, l'été 1995, à 2 mois de ses 50 ans, a senti ses premières fasciculations alors que nous étions en vacances en stage sportif (nous faisions de la danse sur glace ensemble.)
Il était rhumatologue et a fait son diagnostic immédiatement. Il a interrogé plusieurs neurologues et il a fallu un an, alors qu'il était très angoissé, pour que le dernier consulté accepte enfin de lui dire que c'était peut-être une SLA. Il faut dire qu'il n'y avait pas de remède et que le Rilutek n'allait pouvoir être délivré sur le marché qu'en janvier 97.
Quand la maladie a été annoncée, cela a été pour moi un coup de massue car j'espérais que mon mari se trompait. Nous avions connu une dame quelques années avant qui avait eu la SLA et qui en était morte en 1 ans ½. C'était donc cette image qu'avait pour moi la SLA. Je pensais que mon mari allait mourir dans les quelques mois à venir.
L'évolution ayant été plus lente je me suis dite que chaque jour serait un jour de bonheur en plus.
C'était un homme hyper-actif (ce qui est une des caractéristiques de certains malades SLA).
Il avait au moins 4 vies professionnelles : celle de rhumatologue dans un cabinet privé en Seine-St Denis, celle de chef de service dans un service de médecine physique et rééducation à Chantilly, celle de Directeur de l'Ecole Nationale de Kinésithérapie de St Maurice (Val de Marne) et celle de médecin international de patinage. Nous nous sommes rencontrés dans un club de danse sur glace et il trouvait encore le temps de s'entraîner 3 ou 4 fois par semaine.
Je n'oublierai pas non plus la quantité de livres qu'il était capable d'ingurgiter par semaine.
Nous n'avons pas eu d'enfants.
J'étais institutrice spécialisée pour les enfants handicapés moteurs et déficients physiques et je travaillais à l'hôpital Trousseau après avoir travaillé de nombreuses années à l'Hôpital de Garches. Cela m'a beaucoup aidée car le handicap ne me faisait pas peur et je pouvais anticiper sans angoisses l'organisation matérielle pour faciliter la vie.
Nous avions la chance d'habiter un pavillon de plain-pied en banlieue parisienne.
La première des choses importantes pour moi a été de penser des aménagements facilitant sa vie. Je ne voulais pas que des obstacles à la vie courante puissent venir s'ajouter au traumatisme du handicap.
Cette maladie dans sa rapide évolution est suffisamment traumatisante (le malade devant s'adapter perpétuellement à un handicap de plus en plus important) pour ne pas ajouter le handicap matériel.
La tâche de l'accompagnant est là délicat car il faut anticiper sans brusquer le malade qui peut nier le besoin d'aide matérielle.
Dés le diagnostic j'ai fait installer un plan incliné, rampes, porte coulissante aux WC avec des barres d'appui, un peu plus tard j'ai fait enlever le bac à douche, pour mettre un carrelage de plain-pied et ainsi pouvoir le doucher sur une chaise roulante.
Il y a eu réaménagement des meubles pour un accès plus facile et j'utilisais mon imagination pour trouver des petits trucs pour le confort. Quelques exemples :
Un arceau non pas posé mais glissé sous le matelas pour que le drap et la couverture ne pèsent pas sur ses pieds et ne gêne pas les mouvements entre nous, une sangle accrochée au lit qu'il pouvait tirer pour se retourner dans le lit, etc.
Chaque étape de la maladie a demandé de s'adapter à un nouveau matériel qui pour le malade est difficile à accepter et à anticiper.
Parfois je n'ai pas pu éviter que ce soient les obstacles qui entraînent l'acceptation du matériel aidant.
Une canne, puis deux cannes, puis un déambulateur ; puis la pire des étapes, le fauteuil roulant. J'en avais emprunté un à l'association, que j'avais rangé dans le garage en attendant le moment favorable.
Je lisais les magazines spécialisés (APF et autres) et j'avais été attirée par les scooters électriques qui semblaient avoir une image plus ludique, moins "handicapante" que le fauteuil roulant. Je lui en ai fait la proposition et il en a adopté un pour ses étrennes 98. Cela lui a été très utile et agréable d'usage.
J'étais bien sûr son accompagnante principale, mais il a très bien su se faire accompagner par tous ses collaborateurs et collaboratrices. Ce qui lui a permis de pouvoir travailler jusqu'à la fin. Il a vraiment été merveilleusement aidé. Dans tous ses lieux de travail chacun mettait ses compétences pour trouver l'astuce qui l'aiderait.
Le directeur de la clinique de Chantilly lui avait même offert un scooter électrique pour se déplacer dans les bâtiments car mon mari ne pouvait pas emporter le sien en voiture.
Famille et amis ont toujours été discrètement présents et disponibles et cela a été très précieux.
J'ai essayé d'être la moins encombrante possible pour ma famille et mes amis mais quand j'avais un réel besoin je n'ai pas hésité à solliciter les uns ou les autres.
Ma famille et mes amis ont été merveilleux. Une seule amie m'a fait réaliser que la bonne volonté pouvait devenir pesante. Elle avait toujours pensé à ci à ça, elle n'osait pas me parler de ci ou de ça, elle me conseillait ceci ou cela ! elle pensait savoir mieux que moi ce qu'il fallait à mon mari. C'était insupportable !
Cela m'a fait réfléchir aux qualités de l'amitié : discrétion et disponibilité.
Quand les gens me demandent comment aider un de leurs amis malade je leur dis n'ayez pas le besoin d'aider, soyez attentif et attendez l'occasion ! Soyez naturels !
Vie de tous les jours
Suite au diagnostic, il a arrêté bien sûr son activité sportive mais il cachait sa maladie et ne voulait pas que j'en parle. Les gens se posaient des questions. Il inventait qu'il avait une entorse, une nécrose de l'astragale... Cela a été très dur pour moi. Je me suis autorisée à l'annoncer à une poignée de très proches et il a fallu un an pour qu'il m'autorise à en parler librement. Je pensais que cacher la maladie risquait de lui porter tort et que les gens en s'interrogeant pouvaient faire des gaffes douloureuses pour lui.
Du genre : tu fais bien du cinéma avec ta canne !
Une kiné à Chantilly lui demande : Alors vous avez toujours vos problèmes de pieds ?
Il revenait à la maison en me disant :
"Comment puis-je-m'en sortir ?" Il pleurait en disant qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait l'impression de se leurrer sur lui-même, qu'il ne pouvait plus rien faire, qu'il était très malheureux, qu'il essayait de sourire, de paraître heureux mais que depuis la première seconde le matin jusqu'à la dernière le soir il était malheureux.
Je peux témoigner que dire la maladie rend au contraire les gens compatissants, attentifs, généreux et que cela enlève tout malentendu. Nous n'avons pas perdu un seul ami et avons été entourés jusqu'au bout et encore après.
Il faut reconnaître qu'il avait un caractère jovial, plein d'humour et qu'il ne se plaignait jamais devant les autres. Il savait bien que c'était la condition pour ne pas indisposer l'entourage. Il me réservait ses moments de découragement et de désespoir. Mais l'humour est un bon remède et j'essayais d'y avoir recours chaque fois que je pouvais.
Un jour, déprimé, il me dit :
- je suis un vrai légume !
- t'es quoi ? un p'tit chou ?
- bien répondu !
Je comprenais, mais je me sentais parfois bien impuissante à soulager sa peine. J'avais même parfois l'impression que cette charge énorme à traîner ralentissait ma marche.
La seule chose qui me paraissait importante à lui dire était que nous devions nous respecter et si nous voulions rester ensemble il fallait essayer de ne jamais se rendre insupportable à l'autre.
La maltraitance est si facile à atteindre ! L'accompagnant devient tout puissant devant la personne dépendante et en même temps il peut devenir l'objet de tyrannie du malade.
Je me suis toujours appliquée à écouter ce qu'il me disait et à lui dire quand quelque chose n'allait pas. Il n'y a qu'ainsi que l'amour peut grandir et non pas s'éteindre.
C'était le fait de se voir confronté à son handicap face aux autres qui le démolissait le plus. Car même connaissant la maladie il arrivait tellement bien à se la nier.
Il revenait malheureux du travail en me disant : "tout le monde m'a dit que je boitais ce matin"
Il ne voulait pas penser que cela se voyait.
L'accompagnant est là, et doit éponger les souffrances et je savais que je devais être son pilier sur lequel il ne devait pas avoir d'hésitation à s'appuyer.
Le regard des autres est le point douloureux pour, je pense, tous les malades.
Je dois dire qu'il a été remarquable et qu'il a dominé cette peur du regard des autres tout au long de sa maladie. Mon rôle a été de toujours l'aider avec une grande discrétion pour éviter que le regard de l'autre ne devienne de la pitié.
Quand il perdait les forces de ses jambes mon épaule était là. Quand il a commencé à perdre la force des bras je me souviens que je soutenais discrètement son coude pour que la fourchette atteigne la bouche et que ses difficultés passent inaperçues, etc.
J'ai eu peur que lorsqu'il perdrait l'usage de ses mains il ne veuille plus sortir manger à l'extérieur. Heureusement sa sociabilité et ses besoins relationnels dans le travail l'ont conduit à dominer son amour propre et il a toujours trouvé autour de lui des mains disponibles pour l'aider.
Il n'y a pas seulement le regard des autres qui entre en jeu dans la vie de tous les jours.
Il y a les moments intimes comme la toilette ou le passage aux WC.
Selon, sans doute, les relations que l'on a dans un couple, certains préfèrent l'aide d'un tiers.
Je voudrais insister là sur le fait que c'est quelque chose de très personnel et je ne pense pas que l'on puisse donner des conseils.
Je me souviens de l'épouse d'un malade avec qui j'avais lié amitié et qui m'avait mise en garde en me disant que s'occuper de la toilette de son mari brisait l'amour. Cela m'avait beaucoup perturbée. Je ne voulais pas faire quelque chose qui aurait pu mettre notre amour en péril mais je ne comprenais pas pourquoi cela aurait pu l'y mettre. J'ai dû interroger un psychothérapeute qui m'a rassurée. Je peux dire maintenant que cela n'a rien gâché et que c'était même pour moi des moments importants pour lui exprimer ma tendresse et lui n'a jamais voulu d'une personne extérieure.
La seule chose qu'il a acceptée et qui lui faisait dire : "tout le monde connaît ma zigounette", c'était de se faire aider à uriner pendant ses journées de travail. La petite bouteille plastique nous a été très précieuse au cours des déplacements.
L'idée de suicide est quelque chose qui revenait périodiquement au gré de l'évolution et un jour il m'avait dit :
- c'est dur de décider de vivre et non pas de mourir.
Je crois que pour son moral la plus difficile des étapes a été le fauteuil roulant comme je pense pour beaucoup de malades. Comment l'a-t-il accepté ? C'est à l'occasion d'un voyage aux Etats Unis, à Minneapolis, que j'ai insisté sur le manque de liberté que nous aurions si nous ne pouvions pas nous déplacer et sur le fait qu'aux Etats-Unis le handicap était vécu différemment. Là-bas, être en fauteuil ne dérangeait pas le regard des autres. Il a accepté. Cela a été la liberté retrouvée et la vie a pu continuer plus facile et joyeuse avec cet outil pour remplacer les jambes. Il s'est aperçu que le regard de ses amis et connaissances ne changeait pas. L'important pour lui était de ne pas devenir un objet que l'on promène. Mais avec lui il n'y avait pas de risques et j'essayais d'être vigilante.
L'étape de l'arrêt de la conduite automobile a été très difficile à vivre aussi. Il a fallu qu'il cogne un arbre pour accepter de prendre un chauffeur en guise d'auxiliaire de vie.
L'intrusion de tierces-personnes a été difficile à vivre pour lui mais pour moi aussi car cela dérange la vie privée et ce ne sont pas toujours des personnes faciles à gérer. Le lève-personne est beaucoup plus facile à gérer que la personne qui aide à lever.
Si pour mon mari le travail était sa vie, pour moi mon travail était devenu une charge et je n'arrivais plus à concilier les deux, l'enseignement et l'accompagnement. Ma tête était occupée en permanence et j'ai préféré arrêter de travailler fin 98.
Pendant la journée je pouvais ainsi prendre du temps pour m'organiser, me détendre et me reposer quand j'en avais besoin.
Il a fallu gérer les nuits où il me réveillait pour le tourner et j'avais besoin de grandes siestes.
Je n'avais plus le droit d'être malade.
Pour moi, je crois que l'étape la plus difficile a été lorsqu'il a perdu l'usage de ses membres supérieurs.
Mon esprit quelquefois l'oubliait et j'étais ramenée violemment à la réalité.
Lui, quand il se trouvait devant la réalité de sa maladie, me disait :
"Mais j'ai toujours l'impression que c'est un autre moi-même ; ce n'est pas moi. C'est un autre qui est malade !"
Je lui avais acheté un logiciel de reconnaissance vocale mais il l'a fort peu utilisé car il n'était pas patient et préférait demander à quelqu'un de lui taper les documents.
C'est là que je me suis rendue compte que c'était difficile d'aider car il m'arrivait quand il me demandait de lui taper une lettre de vouloir corriger son expression et cela le mettait en colère : "Tu ne te rends pas compte de ce que c'est de ne pas pouvoir écrire tout seul !"
Il avait raison car c'était vouloir diriger sa pensée.
Cela devait lui être insupportable d'avoir tout le temps à demander les choses.
Il me disait : "on ne peut pas faire autrement que d'en vouloir à l'autre de faire des gestes que l'on pouvait faire bien plus vite".
Il fallait effectivement qu'il me demande chaque geste dont il avait besoin comme se gratter, se moucher, tourner une page, manger, etc. cela devait être épouvantablement éprouvant pour lui.
Quand je lui donnais à manger, il lui arrivait de s'énerver car il trouvait les bouchées trop grosses et avait l'impression que je voulais me débarrasser de la tâche plus vite ! Il fallait alors que je lui explique que je faisais comme pour moi et que j'attendais de lui qu'il me dise ce qui lui convenait.
Mais il lui arrivait aussi de dire en parlant de la lourdeur de sa maladie que je l'aidais vraiment et que c'était comme si j'en portais la moitié.
Nous avions une vie hyperactive. Nous voyagions et nous recevions énormément. Nous avons toujours voulu mener une vie la plus normale possible et nous avons renoncé à peu de déplacements. Il lui est bien sûr arrivé de s'effondrer en rentrant à la maison après un long voyage en voiture. La tension, l'inconfort, la fatigue, devoir se retenir d'aller à la selle, tout ça était une dure épreuve.
C'était sans doute une manière de ne pas prendre le temps de penser et je me demande comment l'un et l'autre avons tenu le coup.
Un jour qu'il n'était pas en forme, il me dit :
- Je n'ai rien envie de faire, je me sens déprimé.
- Je n'ai pas envie que tu sois déprimé, mais j'aimerais que tu aies plus souvent envie de ne rien faire.
- (Sourire) je suis un drôle de guss. Je suis malheureux, c'est dur !
- Je suis ton bâton !
- Tu es ma fée avec sa baguette !
Et ce jour là, nous avons passé un moment à lire tranquillement dehors au soleil, c'était bien agréable !
Il faut aussi parler d'un grand danger qui nous guette vis à vis du malade : celui de croire à la simulation et de ne pas répondre à un réel besoin. L'accompagnant peut être tenté de s'énerver devant une incapacité à faire et ne pas vouloir accepter cette incapacité.
Je me souviens d'un jour où, en lui préparant son petit-déjeuner je me suis sentie énervée par sa faible voix que je n'arrivais pas à entendre et j'ai eu l'impression qu'il ne faisait pas d'effort. Je me demandais s'il le faisait exprès ou non, mais ce n'était hélas que l'expression de sa déficience respiratoire.
Nous parlions quelquefois de la mort mais que ce soit du handicap ou de la mort il ne fallait jamais que ce soit moi qui entame la conversation.
L'ARSla.
Dès le diagnostic, mon mari s'est intéressé à l'association et y a adhéré en 1997. Suite à l'Assemblée générale à laquelle il m'avait demandé d'assister, travaillant à mi-temps à l'époque, j'ai répondu à la demande de l'ARSla de rejoindre l'équipe de bénévoles trop peu nombreuse.
Mon idée était que les services seraient réciproques.
Effectivement, nous nous sommes engagés tous les deux et l'association a été un moteur pour mettre notre énergie au service du combat contre la SLA.
Nous avions besoin d'agir et cela s'est concrétisé dans l'organisation de rencontres avec les adhérents, de colloques pour les kinésithérapeutes et pour les ergothérapeutes, de réalisations de fiches d'aide aux malades et de conseils aux kinésithérapeutes (son domaine).
Mon mari avait été élu au Conseil d'Administration de l'ARSla et avait eu l'initiative des Etats Généraux de la SLA. Si les rencontres avec d'autres malades étaient éprouvantes, elles nous apportaient beaucoup et tout cela a donné un sens à la maladie.
Le suivi médical
Après chaque visite médicale il était à ramasser à la petite cuillère. Il fallait rassurer et positiver. Son médecin, pour qui j'ai gardé de l'amitié et une grande reconnaissance, a toujours été clair et sincère. Sa tâche pourtant n'était pas facile car étant du métier, mon mari ne lui épargnait pas les questions pièges et les réponses le rendaient parfois malheureux car elle ne lui cachait rien.
Tant que le médecin n'avait pas constaté l'évolution il espérait pouvoir la nier.
La question la plus récurrente était "pour combien de temps j'en ai ?", même s'il savait très bien que personne ne pouvait le lui dire.
Quand l'atteinte respiratoire a commencé et que la trachéotomie a été à envisager, afin de savoir si je serais capable d'assumer, j'ai demandé à son médecin si je pouvais aller visiter un malade trachéotomisé. Elle m'a accompagnée chez une malade qui avait accepté de nous recevoir. Au vu de la situation j'ai pu dire à mon mari que je me sentais capable d'assumer et cela lui a permis de faire son choix personnel.
Je garde un mauvais souvenir des quinze jours passés en réanimation pneumo où l'équipe n'a pas répondu à notre attente d'humanité.
Conclusion
Cet accompagnement m'a permis de mesurer combien il était difficile pour les médecins de répondre aux questions des patients et de savoir comment anticiper pour aider le malade.
Une piqûre fait mal mais guérit, une fessée donnée à un enfant fait mal mais lui permet de grandir, annoncer l'évolution d'une maladie fait mal et semble laisser la personne sans espoir. La peur de faire mal est compréhensible mais suite à cet accompagnement et après avoir essuyé bien des larmes j'aimerais rassurer les soignants et leur dire que la vérité est la seule voie qui permette de construire sa vie avec sa maladie et d'éviter, dans la mesure du possible, le déni.
Cet épisode de ma vie, qui m'a fait grandir, a été la révélation de la faculté extraordinaire de l'être humain à s'adapter.
Je peux quand même terminer en disant que sa maladie aura été un enfer pavé de moments de paradis.
Hélène Danowski
Val de Marne - 2007
e-mail : [email protected]
Tweeter
Retour
' + new_content2.html() + '
';
is_gauche = false;
}
else {
new_content3 = '' + new_content2.html() + '
';
is_gauche = true;
}
if (new_content2.html() != null) new_content += new_content3;
}
if (mea) {
var nbr = page_index*items_per_page+max_elem;
new_content2 = jQuery('.global_act .1_act:eq('+nbr+')').clone();
if (is_gauche) { new_content3 = '' + new_content2.html() + '
'; is_gauche = false; }
else { new_content3 = '' + new_content2.html() + '
'; is_gauche = true; }
if (new_content2.html() != null) new_content += new_content3;
}
$('#Searchresult').empty().append(new_content);
return false;
}
/* Initialisation function for pagination */
function initPagination() {
// count entries inside the hidden content
var num_entries = jQuery('.global_act .1_act').length;
var actu_mea = jQuery('.global_act .actumea').length;
// Create content inside pagination element
$("#Pagination2").pagination(num_entries-actu_mea, {
callback: pageselectCallback,
items_per_page:4,
prev_text: ""
});
$("#Pagination2").trigger('setPage', [0]);
if ( num_entries > 0 )
{
$("#Pagination2").css({ display: 'block' });
}
}
// When document is ready, initialize pagination
$(document).ready(function(){
initPagination();
if ($('.pagination').html() == '<1<>') {
$('.pagination').css('display', 'none');
}
});
2007 - Hélène DANOWSKI
Je voudrais tout d'abord remercier Emmanuel Hirsch de m'avoir accordé sa confiance en me demandant d'apporter ce témoignage sur l'accompagnement de mon mari atteint de SLA depuis l'été 1995, où les premières fasciculations musculaires sont apparues, jusqu'en janvier 2003 où il est mort, la maladie ayant atteint ses muscles respiratoires, et la trachéotomie pratiquée ne lui ayant pas permis de prolonger sa vie.
J'insisterai sur le fait que c'est un témoignage.
Chaque accompagnement est personnel et dépend de la personnalité de chacun des intervenants.
En premier, là ou les personnes qui vivent avec le malade, puis la famille, les amis et les soignants.
Mon témoignage sera sûrement différent de celui qu'auraient pu faire les accompagnants de mon voisin.
Chacun a sa manière d'être, de penser et d'agir.
Je vais essayer de vous dire ce qui m'a paru important pendant ses sept années d'accompagnement.
Quelques mots me viennent en premier pour l'accompagnant : entendre les angoisses, rassurer, soutenir, encourager, anticiper, et surtout aider le malade à vivre la vie quotidienne.
Présentation de la situation :
Mon mari, l'été 1995, à 2 mois de ses 50 ans, a senti ses premières fasciculations alors que nous étions en vacances en stage sportif (nous faisions de la danse sur glace ensemble.)
Il était rhumatologue et a fait son diagnostic immédiatement. Il a interrogé plusieurs neurologues et il a fallu un an, alors qu'il était très angoissé, pour que le dernier consulté accepte enfin de lui dire que c'était peut-être une SLA. Il faut dire qu'il n'y avait pas de remède et que le Rilutek n'allait pouvoir être délivré sur le marché qu'en janvier 97.
Quand la maladie a été annoncée, cela a été pour moi un coup de massue car j'espérais que mon mari se trompait. Nous avions connu une dame quelques années avant qui avait eu la SLA et qui en était morte en 1 ans ½. C'était donc cette image qu'avait pour moi la SLA. Je pensais que mon mari allait mourir dans les quelques mois à venir.
L'évolution ayant été plus lente je me suis dite que chaque jour serait un jour de bonheur en plus.
C'était un homme hyper-actif (ce qui est une des caractéristiques de certains malades SLA).
Il avait au moins 4 vies professionnelles : celle de rhumatologue dans un cabinet privé en Seine-St Denis, celle de chef de service dans un service de médecine physique et rééducation à Chantilly, celle de Directeur de l'Ecole Nationale de Kinésithérapie de St Maurice (Val de Marne) et celle de médecin international de patinage. Nous nous sommes rencontrés dans un club de danse sur glace et il trouvait encore le temps de s'entraîner 3 ou 4 fois par semaine.
Je n'oublierai pas non plus la quantité de livres qu'il était capable d'ingurgiter par semaine.
Nous n'avons pas eu d'enfants.
J'étais institutrice spécialisée pour les enfants handicapés moteurs et déficients physiques et je travaillais à l'hôpital Trousseau après avoir travaillé de nombreuses années à l'Hôpital de Garches. Cela m'a beaucoup aidée car le handicap ne me faisait pas peur et je pouvais anticiper sans angoisses l'organisation matérielle pour faciliter la vie.
Nous avions la chance d'habiter un pavillon de plain-pied en banlieue parisienne.
La première des choses importantes pour moi a été de penser des aménagements facilitant sa vie. Je ne voulais pas que des obstacles à la vie courante puissent venir s'ajouter au traumatisme du handicap.
Cette maladie dans sa rapide évolution est suffisamment traumatisante (le malade devant s'adapter perpétuellement à un handicap de plus en plus important) pour ne pas ajouter le handicap matériel.
La tâche de l'accompagnant est là délicat car il faut anticiper sans brusquer le malade qui peut nier le besoin d'aide matérielle.
Dés le diagnostic j'ai fait installer un plan incliné, rampes, porte coulissante aux WC avec des barres d'appui, un peu plus tard j'ai fait enlever le bac à douche, pour mettre un carrelage de plain-pied et ainsi pouvoir le doucher sur une chaise roulante.
Il y a eu réaménagement des meubles pour un accès plus facile et j'utilisais mon imagination pour trouver des petits trucs pour le confort. Quelques exemples :
Un arceau non pas posé mais glissé sous le matelas pour que le drap et la couverture ne pèsent pas sur ses pieds et ne gêne pas les mouvements entre nous, une sangle accrochée au lit qu'il pouvait tirer pour se retourner dans le lit, etc.
Chaque étape de la maladie a demandé de s'adapter à un nouveau matériel qui pour le malade est difficile à accepter et à anticiper.
Parfois je n'ai pas pu éviter que ce soient les obstacles qui entraînent l'acceptation du matériel aidant.
Une canne, puis deux cannes, puis un déambulateur ; puis la pire des étapes, le fauteuil roulant. J'en avais emprunté un à l'association, que j'avais rangé dans le garage en attendant le moment favorable.
Je lisais les magazines spécialisés (APF et autres) et j'avais été attirée par les scooters électriques qui semblaient avoir une image plus ludique, moins "handicapante" que le fauteuil roulant. Je lui en ai fait la proposition et il en a adopté un pour ses étrennes 98. Cela lui a été très utile et agréable d'usage.
J'étais bien sûr son accompagnante principale, mais il a très bien su se faire accompagner par tous ses collaborateurs et collaboratrices. Ce qui lui a permis de pouvoir travailler jusqu'à la fin. Il a vraiment été merveilleusement aidé. Dans tous ses lieux de travail chacun mettait ses compétences pour trouver l'astuce qui l'aiderait.
Le directeur de la clinique de Chantilly lui avait même offert un scooter électrique pour se déplacer dans les bâtiments car mon mari ne pouvait pas emporter le sien en voiture.
Famille et amis ont toujours été discrètement présents et disponibles et cela a été très précieux.
J'ai essayé d'être la moins encombrante possible pour ma famille et mes amis mais quand j'avais un réel besoin je n'ai pas hésité à solliciter les uns ou les autres.
Ma famille et mes amis ont été merveilleux. Une seule amie m'a fait réaliser que la bonne volonté pouvait devenir pesante. Elle avait toujours pensé à ci à ça, elle n'osait pas me parler de ci ou de ça, elle me conseillait ceci ou cela ! elle pensait savoir mieux que moi ce qu'il fallait à mon mari. C'était insupportable !
Cela m'a fait réfléchir aux qualités de l'amitié : discrétion et disponibilité.
Quand les gens me demandent comment aider un de leurs amis malade je leur dis n'ayez pas le besoin d'aider, soyez attentif et attendez l'occasion ! Soyez naturels !
Vie de tous les jours
Suite au diagnostic, il a arrêté bien sûr son activité sportive mais il cachait sa maladie et ne voulait pas que j'en parle. Les gens se posaient des questions. Il inventait qu'il avait une entorse, une nécrose de l'astragale... Cela a été très dur pour moi. Je me suis autorisée à l'annoncer à une poignée de très proches et il a fallu un an pour qu'il m'autorise à en parler librement. Je pensais que cacher la maladie risquait de lui porter tort et que les gens en s'interrogeant pouvaient faire des gaffes douloureuses pour lui.
Du genre : tu fais bien du cinéma avec ta canne !
Une kiné à Chantilly lui demande : Alors vous avez toujours vos problèmes de pieds ?
Il revenait à la maison en me disant :
"Comment puis-je-m'en sortir ?" Il pleurait en disant qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait l'impression de se leurrer sur lui-même, qu'il ne pouvait plus rien faire, qu'il était très malheureux, qu'il essayait de sourire, de paraître heureux mais que depuis la première seconde le matin jusqu'à la dernière le soir il était malheureux.
Je peux témoigner que dire la maladie rend au contraire les gens compatissants, attentifs, généreux et que cela enlève tout malentendu. Nous n'avons pas perdu un seul ami et avons été entourés jusqu'au bout et encore après.
Il faut reconnaître qu'il avait un caractère jovial, plein d'humour et qu'il ne se plaignait jamais devant les autres. Il savait bien que c'était la condition pour ne pas indisposer l'entourage. Il me réservait ses moments de découragement et de désespoir. Mais l'humour est un bon remède et j'essayais d'y avoir recours chaque fois que je pouvais.
Un jour, déprimé, il me dit :
- je suis un vrai légume !
- t'es quoi ? un p'tit chou ?
- bien répondu !
Je comprenais, mais je me sentais parfois bien impuissante à soulager sa peine. J'avais même parfois l'impression que cette charge énorme à traîner ralentissait ma marche.
La seule chose qui me paraissait importante à lui dire était que nous devions nous respecter et si nous voulions rester ensemble il fallait essayer de ne jamais se rendre insupportable à l'autre.
La maltraitance est si facile à atteindre ! L'accompagnant devient tout puissant devant la personne dépendante et en même temps il peut devenir l'objet de tyrannie du malade.
Je me suis toujours appliquée à écouter ce qu'il me disait et à lui dire quand quelque chose n'allait pas. Il n'y a qu'ainsi que l'amour peut grandir et non pas s'éteindre.
C'était le fait de se voir confronté à son handicap face aux autres qui le démolissait le plus. Car même connaissant la maladie il arrivait tellement bien à se la nier.
Il revenait malheureux du travail en me disant : "tout le monde m'a dit que je boitais ce matin"
Il ne voulait pas penser que cela se voyait.
L'accompagnant est là, et doit éponger les souffrances et je savais que je devais être son pilier sur lequel il ne devait pas avoir d'hésitation à s'appuyer.
Le regard des autres est le point douloureux pour, je pense, tous les malades.
Je dois dire qu'il a été remarquable et qu'il a dominé cette peur du regard des autres tout au long de sa maladie. Mon rôle a été de toujours l'aider avec une grande discrétion pour éviter que le regard de l'autre ne devienne de la pitié.
Quand il perdait les forces de ses jambes mon épaule était là. Quand il a commencé à perdre la force des bras je me souviens que je soutenais discrètement son coude pour que la fourchette atteigne la bouche et que ses difficultés passent inaperçues, etc.
J'ai eu peur que lorsqu'il perdrait l'usage de ses mains il ne veuille plus sortir manger à l'extérieur. Heureusement sa sociabilité et ses besoins relationnels dans le travail l'ont conduit à dominer son amour propre et il a toujours trouvé autour de lui des mains disponibles pour l'aider.
Il n'y a pas seulement le regard des autres qui entre en jeu dans la vie de tous les jours.
Il y a les moments intimes comme la toilette ou le passage aux WC.
Selon, sans doute, les relations que l'on a dans un couple, certains préfèrent l'aide d'un tiers.
Je voudrais insister là sur le fait que c'est quelque chose de très personnel et je ne pense pas que l'on puisse donner des conseils.
Je me souviens de l'épouse d'un malade avec qui j'avais lié amitié et qui m'avait mise en garde en me disant que s'occuper de la toilette de son mari brisait l'amour. Cela m'avait beaucoup perturbée. Je ne voulais pas faire quelque chose qui aurait pu mettre notre amour en péril mais je ne comprenais pas pourquoi cela aurait pu l'y mettre. J'ai dû interroger un psychothérapeute qui m'a rassurée. Je peux dire maintenant que cela n'a rien gâché et que c'était même pour moi des moments importants pour lui exprimer ma tendresse et lui n'a jamais voulu d'une personne extérieure.
La seule chose qu'il a acceptée et qui lui faisait dire : "tout le monde connaît ma zigounette", c'était de se faire aider à uriner pendant ses journées de travail. La petite bouteille plastique nous a été très précieuse au cours des déplacements.
L'idée de suicide est quelque chose qui revenait périodiquement au gré de l'évolution et un jour il m'avait dit :
- c'est dur de décider de vivre et non pas de mourir.
Je crois que pour son moral la plus difficile des étapes a été le fauteuil roulant comme je pense pour beaucoup de malades. Comment l'a-t-il accepté ? C'est à l'occasion d'un voyage aux Etats Unis, à Minneapolis, que j'ai insisté sur le manque de liberté que nous aurions si nous ne pouvions pas nous déplacer et sur le fait qu'aux Etats-Unis le handicap était vécu différemment. Là-bas, être en fauteuil ne dérangeait pas le regard des autres. Il a accepté. Cela a été la liberté retrouvée et la vie a pu continuer plus facile et joyeuse avec cet outil pour remplacer les jambes. Il s'est aperçu que le regard de ses amis et connaissances ne changeait pas. L'important pour lui était de ne pas devenir un objet que l'on promène. Mais avec lui il n'y avait pas de risques et j'essayais d'être vigilante.
L'étape de l'arrêt de la conduite automobile a été très difficile à vivre aussi. Il a fallu qu'il cogne un arbre pour accepter de prendre un chauffeur en guise d'auxiliaire de vie.
L'intrusion de tierces-personnes a été difficile à vivre pour lui mais pour moi aussi car cela dérange la vie privée et ce ne sont pas toujours des personnes faciles à gérer. Le lève-personne est beaucoup plus facile à gérer que la personne qui aide à lever.
Si pour mon mari le travail était sa vie, pour moi mon travail était devenu une charge et je n'arrivais plus à concilier les deux, l'enseignement et l'accompagnement. Ma tête était occupée en permanence et j'ai préféré arrêter de travailler fin 98.
Pendant la journée je pouvais ainsi prendre du temps pour m'organiser, me détendre et me reposer quand j'en avais besoin.
Il a fallu gérer les nuits où il me réveillait pour le tourner et j'avais besoin de grandes siestes.
Je n'avais plus le droit d'être malade.
Pour moi, je crois que l'étape la plus difficile a été lorsqu'il a perdu l'usage de ses membres supérieurs.
Mon esprit quelquefois l'oubliait et j'étais ramenée violemment à la réalité.
Lui, quand il se trouvait devant la réalité de sa maladie, me disait :
"Mais j'ai toujours l'impression que c'est un autre moi-même ; ce n'est pas moi. C'est un autre qui est malade !"
Je lui avais acheté un logiciel de reconnaissance vocale mais il l'a fort peu utilisé car il n'était pas patient et préférait demander à quelqu'un de lui taper les documents.
C'est là que je me suis rendue compte que c'était difficile d'aider car il m'arrivait quand il me demandait de lui taper une lettre de vouloir corriger son expression et cela le mettait en colère : "Tu ne te rends pas compte de ce que c'est de ne pas pouvoir écrire tout seul !"
Il avait raison car c'était vouloir diriger sa pensée.
Cela devait lui être insupportable d'avoir tout le temps à demander les choses.
Il me disait : "on ne peut pas faire autrement que d'en vouloir à l'autre de faire des gestes que l'on pouvait faire bien plus vite".
Il fallait effectivement qu'il me demande chaque geste dont il avait besoin comme se gratter, se moucher, tourner une page, manger, etc. cela devait être épouvantablement éprouvant pour lui.
Quand je lui donnais à manger, il lui arrivait de s'énerver car il trouvait les bouchées trop grosses et avait l'impression que je voulais me débarrasser de la tâche plus vite ! Il fallait alors que je lui explique que je faisais comme pour moi et que j'attendais de lui qu'il me dise ce qui lui convenait.
Mais il lui arrivait aussi de dire en parlant de la lourdeur de sa maladie que je l'aidais vraiment et que c'était comme si j'en portais la moitié.
Nous avions une vie hyperactive. Nous voyagions et nous recevions énormément. Nous avons toujours voulu mener une vie la plus normale possible et nous avons renoncé à peu de déplacements. Il lui est bien sûr arrivé de s'effondrer en rentrant à la maison après un long voyage en voiture. La tension, l'inconfort, la fatigue, devoir se retenir d'aller à la selle, tout ça était une dure épreuve.
C'était sans doute une manière de ne pas prendre le temps de penser et je me demande comment l'un et l'autre avons tenu le coup.
Un jour qu'il n'était pas en forme, il me dit :
- Je n'ai rien envie de faire, je me sens déprimé.
- Je n'ai pas envie que tu sois déprimé, mais j'aimerais que tu aies plus souvent envie de ne rien faire.
- (Sourire) je suis un drôle de guss. Je suis malheureux, c'est dur !
- Je suis ton bâton !
- Tu es ma fée avec sa baguette !
Et ce jour là, nous avons passé un moment à lire tranquillement dehors au soleil, c'était bien agréable !
Il faut aussi parler d'un grand danger qui nous guette vis à vis du malade : celui de croire à la simulation et de ne pas répondre à un réel besoin. L'accompagnant peut être tenté de s'énerver devant une incapacité à faire et ne pas vouloir accepter cette incapacité.
Je me souviens d'un jour où, en lui préparant son petit-déjeuner je me suis sentie énervée par sa faible voix que je n'arrivais pas à entendre et j'ai eu l'impression qu'il ne faisait pas d'effort. Je me demandais s'il le faisait exprès ou non, mais ce n'était hélas que l'expression de sa déficience respiratoire.
Nous parlions quelquefois de la mort mais que ce soit du handicap ou de la mort il ne fallait jamais que ce soit moi qui entame la conversation.
L'ARSla.
Dès le diagnostic, mon mari s'est intéressé à l'association et y a adhéré en 1997. Suite à l'Assemblée générale à laquelle il m'avait demandé d'assister, travaillant à mi-temps à l'époque, j'ai répondu à la demande de l'ARSla de rejoindre l'équipe de bénévoles trop peu nombreuse.
Mon idée était que les services seraient réciproques.
Effectivement, nous nous sommes engagés tous les deux et l'association a été un moteur pour mettre notre énergie au service du combat contre la SLA.
Nous avions besoin d'agir et cela s'est concrétisé dans l'organisation de rencontres avec les adhérents, de colloques pour les kinésithérapeutes et pour les ergothérapeutes, de réalisations de fiches d'aide aux malades et de conseils aux kinésithérapeutes (son domaine).
Mon mari avait été élu au Conseil d'Administration de l'ARSla et avait eu l'initiative des Etats Généraux de la SLA. Si les rencontres avec d'autres malades étaient éprouvantes, elles nous apportaient beaucoup et tout cela a donné un sens à la maladie.
Le suivi médical
Après chaque visite médicale il était à ramasser à la petite cuillère. Il fallait rassurer et positiver. Son médecin, pour qui j'ai gardé de l'amitié et une grande reconnaissance, a toujours été clair et sincère. Sa tâche pourtant n'était pas facile car étant du métier, mon mari ne lui épargnait pas les questions pièges et les réponses le rendaient parfois malheureux car elle ne lui cachait rien.
Tant que le médecin n'avait pas constaté l'évolution il espérait pouvoir la nier.
La question la plus récurrente était "pour combien de temps j'en ai ?", même s'il savait très bien que personne ne pouvait le lui dire.
Quand l'atteinte respiratoire a commencé et que la trachéotomie a été à envisager, afin de savoir si je serais capable d'assumer, j'ai demandé à son médecin si je pouvais aller visiter un malade trachéotomisé. Elle m'a accompagnée chez une malade qui avait accepté de nous recevoir. Au vu de la situation j'ai pu dire à mon mari que je me sentais capable d'assumer et cela lui a permis de faire son choix personnel.
Je garde un mauvais souvenir des quinze jours passés en réanimation pneumo où l'équipe n'a pas répondu à notre attente d'humanité.
Conclusion
Cet accompagnement m'a permis de mesurer combien il était difficile pour les médecins de répondre aux questions des patients et de savoir comment anticiper pour aider le malade.
Une piqûre fait mal mais guérit, une fessée donnée à un enfant fait mal mais lui permet de grandir, annoncer l'évolution d'une maladie fait mal et semble laisser la personne sans espoir. La peur de faire mal est compréhensible mais suite à cet accompagnement et après avoir essuyé bien des larmes j'aimerais rassurer les soignants et leur dire que la vérité est la seule voie qui permette de construire sa vie avec sa maladie et d'éviter, dans la mesure du possible, le déni.
Cet épisode de ma vie, qui m'a fait grandir, a été la révélation de la faculté extraordinaire de l'être humain à s'adapter.
Je peux quand même terminer en disant que sa maladie aura été un enfer pavé de moments de paradis.
Hélène Danowski
Val de Marne - 2007
e-mail : [email protected]
Tweeter
Retour




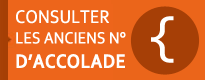


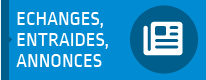


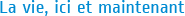
 ARSLA 75 avenue de la République, 75011 Paris - www.arsla-asso.com - Fax : 01 43 38 31 59 -
ARSLA 75 avenue de la République, 75011 Paris - www.arsla-asso.com - Fax : 01 43 38 31 59 -